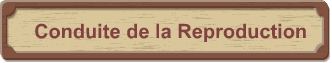
|
|
|
|
Document technique à l'usage des candidats juges La reproduction, c'est avant tout la rencontre entre deux gamètes : un spermatozoïde et un ovule. Pour ne pas manquer ce rendez-vous, il faut naturellement que ces deux cellules sexuelles soient « au mieux de leur forme » au moment de leur rencontre. Si cette rencontre se fait naturellement chez les espèces à ovulation provoquée par le coït (espèce féline par exemple), tout l'art de l'éleveur de chiens consistera à suivre les chaleurs de ses chiennes de manière à détecter avec précision le moment opportun pour la saillie ou l'insémination grâce aux nombreux outils qui sont maintenant à sa disposition. Particularités anatomiques du chien mâle L'anatomie génitale du chien mâle présente les caractéristiques suivantes : L'os pénien Les bulbes érectiles sont responsables du verrouillage des deux partenaires lors de la saillie et de la stimulation des contractions vaginales participant à l'ascension des spermatozoïdes vers les cornes utérines. A noter que la partie extériorisable de l'appareil génital mâle, appelée à tort pénis, n'est en fait que le gland du pénis qui comprend les bulbes érectiles. Le muscle bulbocaverneux s'étend jusqu'au périnée. Sa stimulation manuelle peut faciliter l'éjaculation chez un étalon difficile à prélever (faible libido, stress lié à l'environnement, absence de chiennes en chaleur...). Particularités physiologiques du chien mâle . - L'âge d'apparition de la puberté dépend essentiellement du format adulte de la race (de 6 mois chez les races miniatures à 18 mois chez les races géantes) et correspond à la production des premiers spermatozoïdes. La fertilité diminue avec l'âge d'autant plus précocement que les chiens sont de grandes races. - L'éjaculation du chien est longue (parfois plus d'une demi-heure), au goutte à goutte et se déroule en trois phases distinctes facilement reconnaissables et individualisâmes : la phase urétrale translucide jouant le rôle de lubrifiant la phase spermatique, d'aspect laiteux, contenant les spermatozoïdes la phase prostatique, la plus longue, jouant le rôle de diluant permettant d'adapter le volume de la semence à la longueur des voies génitales femelles. Cette dernière est également claire sauf quand elle est anormalement teintée de sang ou de pus (lors de prostatite par exemple). Le nombre de spermatozoïdes émis est fonction du format de la race (un Mâtin de Naples peut en émettre plus de 2 milliards par prélèvement !), de l'âge de l'étalon, de la fréquence des saillies (le stock de spermatozoïdes est renouvelé en moyenne tous les 4 jours), de la durée des périodes d'abstinence (le premier spermogramme est rarement bon après une période d'abstinence de plusieurs mois surtout chez les races de grand format comme les dogues allemands...) et enfin de l'équilibre hormonal du chien (LH, FSH, testostérone, hormones thyroïdiennes). En moyenne, on estime qu'il existe des chances de fécondation non négligeables à partir de 150 millions de spermatozoïdes normaux et mobiles dans l'éjaculât. Les spermatozoïdes sont très sensibles aux variations de leur milieu. Ils survivront très peu de temps dans le milieu extérieur s'ils doivent faire face à une baisse de température, à un contact avec une substance spermicide ou à une manipulation brutale (aiguille d'une seringue par exemple). Ils peuvent cependant survivre environ 5 jours dans les voies génitales femelles mais ne garderont leur pouvoir fécondant qu'environ 48 heures après leur émission. Particularités anatomiques de la femelle Le suivi des chaleurs, la surveillance d'une saillie ou la réalisation d'une insémination chez une chienne nécessitent le rappel des caractéristiques anatomiques suivantes : un vagin très long qui empêche la palpation du col par voie vaginale. la présence d'une fosse clitoridienne Particularités physiologiques de la femelle Dès la puberté qui, comme chez le mâle, apparaît plus tardivement chez les grandes races que chez les petites, le fonctionnement de l'appareil génital femelle adopte un rythme cyclique. Le cycle sexuel de la chienne est qualifié de mono-oestrien (une seule période d'ovulations par cycle) à ovulation spontanée (c'est à dire que l'ovulation ne peut pas être déclenchée par un stimulus extérieur). La durée de chaque phase du cycle peut être variable. Seule la phase de post-oestrus (appelée encore parfois met-oestrus ou di-oestrus) , correspondant à la période de gestation et de lactation admet une durée relativement stable (120 +/- 20 jours). Les chaleurs couvrant les phases de pro-oestrus et d'oestrus durent en moyenne trois semaines mais leur durée dépend de la date d'ovulation elle même variable d'une chienne à l'autre et, pour une même chienne, d'un cycle à l'autre. Ainsi, ce n'est pas parce qu'une chienne aura ovulé une fois 12 jours après les premières pertes sanguines qu'au cycle suivant l'ovulation interviendra à la même date. Environ 20% d'entre elles ovulent plus précocement ou plus tardivement. De même, certaines chiennes n'extériorisent physiologiquement qu'une période de chaleurs par an (ex : Basenji), d'autres trois par an ou encore trois tous les 2 ans. Chaque race présente son lot de particularités qu'il est utile de connaître avant d'entreprendre reproduction et sélection. Contrairement à la majorité des espèces, les ovaires des chiennes commencent à sécréter de la progestérone quelques jours avant l'ovulation. Son taux sanguin (progestéronémie) augmente alors progressivement que la chienne soit fécondée ou non. Les dosages de progestérone permettent donc de témoigner de l'ovulation mais pas de la gestation. Chez la chienne, les ovules sont pondus encore miniatures au stade dit "ovocytaire". Il leur faut généralement 48 heures avant d'être fécondables. Hormis pendant la période d'oestrus, le taux d'oestrogènes
augmente également 2 mois après l'oestrus, que la chienne soit gestante ou non.
Cette élévation explique l'apparition des fausses chaleurs (attraction des
mâles) parfois observées pendant cette période ou à La période d'acceptation du mâle qui entoure généralement l'ovulation est fréquemment accompagnée d'un réflexe caractérisé par une déviation latérale du port de la queue suite à une stimulation vulvaire. Ce signe peut être utilisé par l'éleveur mais doit néanmoins être interprété avec prudence chez certaines femelles acceptant le mâle en dehors de leur période d'ovulation. Influence des paramètres extérieurs Comme dans la plupart des espèces (détenues en parc zoologique par exemple), la reproduction peut chez le Chien être perturbée par de nombreux facteurs psychologiques ou physiques. Facteurs psychologiques Le stress sous toutes ses formes (climatique, mauvaises conditions d'hébergement, surpopulation, manque d'éclairage etc.) diminue les performances reproductrices des chiens. L'exemple le plus démonstratif reste sans doute le stress hiérarchique qui régit les rapports de dominance. En élevage canin, il est facile de pallier la concurrence sexuelle entre mâles en séparant les étalons qui ne sont généralement pas très nombreux. Il est parfois plus difficile de déceler les chiennes soumises qui extérioriseront parfois des chaleurs très discrètes, des pseudogestations et des lactations nerveuses mimant ainsi ce qui se produit dans une meute sauvage. Il n'est pas rare d'observer en élevage canin des troubles de la libido et donc de la fertilité chez des chiens présentant des comportements stéréotypés (tourner en rond, arpentage des courettes, tic du fauve en cage, activités de substitution telles que le léchage ou l'automutilation) qui peuvent être la conséquence d'une mauvaise hygiène de vie (manque d'exercice, absence de distractions). On constate alors soit un amaigrissement lié à l'anorexie, la mauvaise assimilation des aliments, la diarrhée et l’hyperactivité qui accompagnent parfois ces syndromes dépressifs, soit, au contraire, une obésité liée à un comportement boulimique. Facteurs physiques L'obésité peut conduire chez les femelles à ce que l'on appelle le syndrome adiposo-génital caractérisé par des cycles normaux mais des chaleurs tellement discrètes qu'elles ne peuvent être détectées ni par l'éleveur, ni par les étalons. Hormis lors d'obésité, l'alimentation est rarement en cause dans les problèmes d'infertilité affectant des reproducteurs en bon état d'entretien. En revanche, les carences alimentaires peuvent être suspectées lors d'infertilité secondaire à un mauvais état général (poil terne, dépigmentations, séborrhée etc.) ou lors de mortalité périnatale des chiots (insuffisances alimentaires survenant au cours de la fin de gestation et surtout de la lactation). Choix d'un étalon Lors de la puberté, et avant toute saillie ou insémination
avec un mâle dont on ne connaît rien de la descendance, il est prudent de
commencer par contrôler la qualité de sa semence. Le spermogramme (examen
microscopique du sperme) a une valeur prédictive sur le pouvoir fécondant de L'ensemble de ces résultats est alors consigné dans un tableau qui autorise à conclure sur le potentiel de fertilité d'un étalon. Si plusieurs spermogrammes consécutifs sont de mauvaise qualité, il est opportun de s'interroger sur les éventuels traitements médicaux (hormones, antifongiques, corticoïdes, radiothérapie) que l'étalon aurait pu subir récemment ou pendant sa croissance. ^Mieux qu'un spermogramme, la descendance récente d'un
étalon reste la meilleure preuve de sa fertilité et permet également de juger
de la qualité génétique de sa semence par son aptitude à marquer sa
progéniture. Il est prudent de se renseigner également sur l'effectif des
portées dont il a la paternité pour juger de sa prolificité qui semble être en
partie liée à la vitalité et à la concentration de Choix d'une lice Le choix d'une future reproductrice au sein d'une portée procède également d'un pari sur l'avenir. Il se fait essentiellement sur son ascendance. Bien que sa responsabilité génétique sur sa descendance soit identique à celle du mâle (50%), il lui faudra également assumer la lactation et l'éducation de ses chiots. Les critères de sélection de la lice devront donc tenir compte, en dehors de sa valeur génétique intrinsèque, de la facilité de ses mise-bas, de ses aptitudes "laitières", de ses qualités maternelles. DETECTION DE Lorsque l'étalon sélectionné n'est pas disponible en permanence à l'élevage et puisque la coutume veut que ce soit la femelle qui se déplace pour une saillie sur le lieu de résidence du mâle, il convient de choisir le moment opportun pour optimiser les chances de fécondation et éviter ainsi des déplacements et des dépenses inutiles. L'idéal serait donc de pratiquer la saillie ou l'insémination dans les 48 heures suivant la ponte ovocytaire pour que les ovules fécondables et les spermatozoïdes fécondants soient pour la plupart capables d'atteindre le lieu de "rendez-vous" (les oviductes). Les ovules restent fécondables pendant une période de 2 jours après maturation expliquant ainsi les possibilités de super fécondations par 2 pères différents dans l'espèce canine. Compte tenu du délai de survie des spermatozoïdes, l'éleveur bénéficie d'une certaine marge de sécurité. Pour discerner la période d'ovulation chez une chienne en chaleurs, l'éleveur dispose de plusieurs outils de précision variable et complémentaires. La saillie pratiquée systématiquement une douzaine de jours après les premières pertes sanguines puis doublée deux jours plus tard reste un calcul pratique pour l'éleveur. Cependant, environ 20% des chiennes ovulent en dehors de cette période et restent donc vides ou ne mettent bas que quelques chiots. Recherche de l'opportunité d'une césarienne La plupart des races à chanfrein "écrasé" (dites
brachycéphales) comme les Bull-Dogs ou les Pékinois présentent des difficultés
à la mise-bas (dystocies) qui conduisent souvent l'éleveur à planifier une
césarienne. Si celle ci est pratiquée trop tôt, les vétérinaires ont constaté
que les chiots prématurés mourraient quelques heures après la naissance
d'insuffisance respiratoire. Effectuée trop tard, la souffrance foetale liée à
l'attente des chiots dans la filière pelvienne conduit à une anoxie cérébrale.
La viabilité des foetus dans l'espèce canine est en fait conditionnée par la
mise en place tardive d'un surfactant pulmonaire qui détermine à la naissance
les capacités respiratoires des chiots. Cette maturation pulmonaire est
justement concomitante de la chute du taux de progestérone qui survient dans
les jours qui précèdent la date idéale de mise-bas. Le vétérinaire dispose
ainsi, par le simple dosage de la progestérone sanguine chez la mère, d'un
outil précieux pour déterminer avec exactitude si les chiots sont prêts à
survivre à une césarienne. Cette technique a considérablement augmenté le taux
de survie des chiots nés par césarienne, particulièrement dans DOSAGE DE LA LH La LH (hormone lutéinisante, c'est à dire capable de transformer la gangue nourricière de l'ovocyte en corps jaune sécrétant la progestérone) est l'hormone sécrétée par l'hypophyse qui déclenche l'ovulation. La détermination du pic de sécrétion de cette substance met donc en évidence précocement la ponte ovulaire elle-même et non plus ses conséquences (élévation de la progestéronémie). Hormis quelques indications précises dans le diagnostic d'une infertilité, ce dosage n'est pas actuellement utilisé en routine en élevage canin. L'ACCOUPLEMENT NATUREL Après avoir sélectionné les géniteurs et vérifié leurs aptitudes reproductrices, l'éleveur présente la femelle à l'étalon pour une saillie. Dans les races à poils longs, l'éleveur peut faciliter la saillie en préparant la femelle par lissage, écartement ou tonte des poils en région péri vulvaire. L'accouplement commence par une brève phase de cour et de flairage qui fait croître l'excitation des partenaires. L'érection permise par la rigidité de l'os pénien et par l'afflux de sang dans le tissu érectile permet alors l'intromission du pénis. Celle-ci déclenche des contractions vaginales chez la femelle qui favorisent l'ascension des spermatozoïdes, le maintien de l'érection et le verrouillage pendant l'éjaculation de la phase prostatique. Cette phase doit durer au moins 5 minutes mais peut durer plus d'une demi-heure si les mouvements de la femelle maintiennent la striction des bulbes érectiles. Dans la majorité des cas, si le moment est opportun, les deux partenaires choisis se débrouillent très bien tout seuls et il n'est pas nécessaire de les perturber par une quelconque présence. Une observation discrète à distance (ou par un système vidéo) suffit généralement pour vérifier l'acceptation mutuelle et que le verrouillage a bien eu lieu. Notons à ce sujet qu'une saillie sans verrouillage peut cependant être fécondante mais la prolificité est généralement diminuée. Malgré les progrès réalisés dans le diagnostic de l'ovulation, il est plus sécurisant d'assurer systématiquement le doublement de la saillie 48 heures plus tard. Pour ce faire, beaucoup d'éleveurs laissent leur lice pendant quelques jours sur le lieu de résidence de l'étalon après avoir signé avec son propriétaire un contrat de saillie. Si, pour de multiples raisons, la saillie naturelle s'avère impossible entre les deux partenaires sélectionnés, il reste à l'éleveur le recours aux techniques d'insémination artificielle qui se développent de plus en plus dans le milieu cynophile français sous l'impulsion de la SCC. INSEMINATIONS ARTIFICIELLES On appelle insémination artificielle toute technique de reproduction qui aurait été impossible en l'absence d'assistance humaine. Ainsi, le simple prélèvement de la semence du mâle pour le réintroduire immédiatement dans les voies génitales femelles, appelé souvent "assistance à saillie" est une technique d'insémination artificielle dite "en semence fraîche". INSEMINATION EN SEMENCE FRAICHE INDICATIONS Cette technique est utilisée lorsque l'éleveur dispose de deux géniteurs qui ne parviennent pas à s'accoupler pour des raisons diverses: incompatibilité d'humeur inexpérience d'un ou des deux partenaires, étroitesse des voies génitales (atrésie vulvaire, malformations vulvaires ou vaginales, prolapsus vaginal lié à l'imprégnation oestrogénique pendant les chaleurs,...) douleurs d'un des partenaires à la saillie (au niveau des vertèbres, des membres postérieurs, de l'os pénien, du vagin...), manque de libido. TECHNIQUE ET RESULTATS Après avoir vérifié que la femelle se trouve bien en période réceptive, le vétérinaire procède au prélèvement de la semence de l'étalon en présence d'une femelle en chaleurs (qui peut être différente de la chienne à inséminer). Une fois la récolte effectuée, le sperme est contrôlé au microscope sur platine chauffante. Si sa qualité est satisfaisante, l'inséminateur réintroduit la semence à l'aide d'une sonde dans le vagin (sonde vaginale type "Osiris") ou dans l'utérus (sonde utérine) de la femelle. Il est nécessaire de maintenir la femelle les membres postérieurs surélevés pendant une dizaine de minutes à l'issue de l'insémination pour favoriser la progression des spermatozoïdes et éviter les reflux. Pour la même raison, il est conseillé d'éviter de laisser la femelle uriner dans les minutes qui suivent l'insémination. Précisons que l'ensemble de ces étapes doit être réalisé avec de multiples précautions pour éviter tout choc thermique, mécanique, ou chimique aux spermatozoïdes. Si ces précautions sont respectées, la technique d'insémination en semence fraîche doit donner d'aussi bons résultats que la saillie naturelle (environ 80% de gestation). INSEMINATION EN SEMENCE REFRIGEREE INDICATIONS Cette technique est destinée principalement à pallier l'éloignement des deux partenaires en économisant au propriétaire de la lice un déplacement et des frais de pension chez le détenteur de l'étalon. TECHNIQUE ET RESULTATS Un vétérinaire agréé prélève la semence de l'étalon et le
contrôle, puis il réfrigère à L'ensemble de ces opérations doit être réalisé dans les 48 heures suivant le prélèvement et nécessite donc une parfaite synchronisation de tous les intervenants (disponibilité de l'étalon, équipement et formation spécifiques des vétérinaires, suivi rigoureux des chaleurs de la lice, rapidité du transporteur). Cette technique convient donc pour des partenaires qui seraient séparés par une distance moyenne (France métropolitaine ou Europe). Les résultats sont comparables à ceux observés lors de saillie naturelle bien que les manipulations successives risquent de diminuer la vitalité des spermatozoïdes. INSEMINATION EN SEMENCE CONGELEE TECHNIQUE La semence est prélevée par une technique identique aux précédentes. La qualité et le nombre des spermatozoïdes sont ensuite sévèrement contrôlés pour éviter de congeler une semence qui contiendrait moins de 150 millions de spermatozoïdes mobiles ou plus de 30% de formes anormales. Elle est ensuite diluée dans un cryoprotecteur, conditionnée
en paillettes identifiées puis conservée dans des canisters plongés dans de
l'azote liquide à - Ces paillettes ne peuvent pas être utilisées sans le
consentement du propriétaire de l'étalon qui peut convenir avec le propriétaire
de la lice d'un prix de vente dépendant du cours de l'offre et de Les inséminations peuvent être pratiquées par tous les vétérinaires inséminateurs ayant suivi une formation à cette technique. Le sperme peut alors leur être envoyé dans des containers spéciaux pour qu'ils puissent pratiquer l'insémination après décongélation au moment opportun. INDICATIONS ET RESULTATS Seuls les chiens de race inscrits au LOF et confirmés
peuvent avoir accès à cette technique. Il est préférable de profiter de la
période de vitalité maximale de l'étalon pour congeler sa semence et de ne pas attendre
sa sénescence, la menace d'une maladie ou d'une castration thérapeutique pour
en faire Un prélèvement permet généralement d'inséminer une seule chienne, sans même parfois assurer le doublement de la saillie, résultats qui ne sont évidemment pas comparables aux performances des taureaux : un éjaculât dans l'espèce bovine, plus volumineux et 10 fois plus concentré, peut servir à l'insémination de plusieurs centaines de vaches!). Malgré les nombreux contrôles avant et après la congélation et les précautions prises pour éviter les chocs thermiques aux spermatozoïdes (cryoprotecteur pour éviter l'éclatement des cellules, décongélation au bain-marié etc.) l'insémination en semence congelée n'est suivie de gestation que dans 30 à 50% des cas, la prolificité accusant elle aussi une diminution d'environ 15 à 20% par rapport à la saillie naturelle. L'insémination intra-utérine par voie trans-cervicale à l'aide d'une sonde rigide semble permettre, en déposant les spermatozoïdes au delà du col de l'utérus, une amélioration de ces résultats qui restent malgré tout encourageants. DIAGNOSTIC DE GESTATION La fécondation d'un ovule par un spermatozoïde aboutit à la formation d'un oeuf qui doit migrer et subir quelques divisions avant de s'implanter dans la muqueuse utérine. Cette nidation chez la Chienne n'intervient en moyenne que 15 à 17 jours après la fécondation et aboutit à la formation de vésicules embryonnaires visibles à l'échographie à partir de la troisième semaine (18 jours au plus tôt). A partir de la troisième semaine, des mains expérimentées peuvent parfois, par palpation transabdominale, déceler un utérus en chapelet à condition que la chienne ne soit pas trop grasse et que la sangle abdominale soit détendue. Entre 5 et 6 semâmes de gestation, le diamètre de l'utérus atteint celui d'une anse intestinale. Il devient donc difficile pendant cette période de distinguer par cette méthode un utérus gravide d'une anse intestinale renfermant des selles dures. Le dosage de relaxine sanguine permet de détecter une gestation et de faire la différence entre une gestation et une pseudo-gestation à partir du 21ème jour mais n'apporte pas plus d'informations que l'échographie. La radiographie ne devient intéressante qu'en fin de gestation lorsque le squelette des foetus devient calcifié et donc radio-opaque (à partir du 45ème jour). Les autres techniques recherchant les changements de comportement, les battements cardiaques des foetus par auscultation (audibles chez certaines chiennes dans les deux dernières semaines), les modifications sanguines (vitesse de sédimentation, hématocrite), le développement mammaire sont trop tardives ou trop aléatoires pour être utilisées de façon fiable en élevage canin. A l'heure actuelle, le diagnostic de gestation le plus précoce est donc apporté par l'échographie. Il permet de renvoyer le certificat de saillie à la SCC dans le délai imparti de 4 semaines avec une certitude de gestation. QUE FAIRE SI Dans toutes les espèces, la fertilité d'une population n'atteint jamais les 100%. La fertilité maximale constatée dans des élevages canins où les conditions de reproduction sont optimales ne dépasse pas les 85%. Il est même conseillé pour chaque lice, de laisser passer au minimum une période de chaleurs tous les deux ans sans mise à la reproduction. Il faudrait donc attendre qu'une chienne soit restée vide à la suite de deux chaleurs consécutives pour que l'éleveur puisse la suspecter d'infertilité. Sans attendre si longtemps, le vétérinaire peut essayer dès le premier échec de localiser plus précisément la cause de l'infertilité. Il lui sera tout d'abord facile d'éliminer les causes liées à l'étalon en contrôlant sa semence (réalisation de plusieurs spermogrammes) et sa descendance récente. Si l'infertilité est objectivement liée au mâle, il y a généralement peu de chances de récupération et mieux vaut alors changer d'étalon. Une fois cette vérification effectuée, les causes d'infertilité liées à la femelle restent néanmoins nombreuses. Une enquête approfondie incluant le passage en revue du passé de la chienne (cycles précédents), les traitements qui auraient pu être effectués (notamment hormonaux), la date de saillie, le comportement des partenaires, la nature des pertes vulvaires etc. permettra d'orienter le diagnostic vers un trouble de la production des ovules, de la fécondation, de la nidation ou de la gestation. L'origine de tous ces troubles étant essentiellement hormonale dans l'espèce canine, le vétérinaire devra souvent compléter son diagnostic par des dosages hormonaux. Il est évident que le traitement de ces troubles de la fertilité dépend de leur origine. A titre d'exemple, on ne traitera pas de manière identique un impubérisme (absence de puberté) et une imprégnation androgénique bien que les problèmes à résoudre soient identiques à la base (absence de maturation folliculaire). Les traitements font appel à des hormones, soit pour stimuler les glandes déficientes, soit pour remplacer les hormones insuffisantes. Le vétérinaire doit donc toujours les utiliser avec prudence, leur administration risquant de provoquer la mise au repos temporaire ou définitive des glandes responsables de leur production naturelle. A titre d'exemple, l'emploi de progestatifs chez une chienne impubère pour retarder l'apparition de ses premières chaleurs et provoquer par la suite, un retard de croissance et un blocage transitoire ou complet de ses cycles. Nous retiendrons donc qu'il est impératif de s'abstenir de tout usagé préventif ou curatif des hormones sans certitude d'un diagnostic précis de la cause de l'infertilité et de n'y avoir recours qu'après avoir échoué avec les autres possibilités de traitement. ANOMALIES DE LA FECONDATION Comme nous l'avons déjà vu précédemment, la plupart des
échecs de la fécondation sont dus à un mauvais choix de la date de saillie ou
d'insémination. Après exclusion de cette cause, le vétérinaire doit rechercher
les éventuels obstacles à la rencontre des gamètes. Une infection vaginale,
utérine, urinaire ou même prostatique peut provoquer la destruction des
spermatozoïdes ou perturber leur cheminement avant ANOMALIES DE LA NIDATION Une fois les ovules fécondés, les oeufs subissent plusieurs divisions mais restent libres pendant une quinzaine de jours dans les cornes utérines avant de s'implanter dans la muqueuse utérine. Celle-ci doit être prête à les recevoir pour permettre la formation des placentas et donc l'apport nutritif nécessaire au développement des embryons. De nombreux obstacles (infection, hyperplasie glandulo-kystique de l'utérus peuvent à nouveau entraver le déroulement de cette étape. De même, l'utérus des chiennes qui ont des chaleurs trop rapprochées ne dispose pas d'un temps suffisant pour involuer et ne sont donc pas aptes à recevoir les embryons. Un traitement progestatif permet alors d'imposer à l'utérus de ces chiennes un repos compensateur nécessaire à sa maturation. ANOMALIES DE LA GESTATION Les premiers jours du développement des chiots constituent l'embryogenèse et correspondent à la différenciation des tissus. On conçoit donc que, pendant cette période, la chienne soit particulièrement sensible à toutes les maladies ou intoxications qui pourraient l'affecter. C'est pour limiter ces risques de mortalité (résorption embryonnaire, avortement) ou de malformations (tératogenèse) qu'il est conseillé de s'abstenir de tout traitement médicamenteux pendant les 20 premiers jours de gestation. De nombreuses autres causes peuvent également être à l'origine d'une interruption de gestation : incompatibilité génétique entre le mâle et la femelle possédant tous deux une tare récessive létale qui rendrait les embryons homozygotes non viables. certaines anomalies chromosomiques. une multitude de germes réputés abortifs ou tératogènes (Brucella, Bartonella...) virus: herpès, virus de la maladie de Carré... parasites: toxoplasmes... tous les traumatismes, qu'ils soient physiques ou psychologiques, qui peuvent même parfois provoquer des avortements partiels (expulsion d'une partie de la portée et poursuite de la gestation à son terme) involution du corps jaune qui secrète la progestérone, indispensable chez la chienne, pendant toute la durée de la gestation. SURVEILLANCE DE LA MISE-BAS La surveillance de la période péri-natale commence par la visite vétérinaire pré-natale qui devra être effectuée dans la 8ème semaine de gestation : Un examen gynécologique de la chienne permet de déceler
d'éventuels obstacles à Une ou plusieurs radiographies abdominales permettent pendant cette période de dénombrer les foetus avec plus de précision que par échographie. Cet examen permet en outre de déceler d'éventuelles anomalies qui sont souvent à l'origine de dystocies comme l’étroitesse du bassin osseux, les momifications foetales (images de densité gazeuse, dislocations des os) ou encore les disproportions foeto-maternelles. Notons cependant que les positions des foetus décelées par radiographie ne sont pas un bon signe précurseur de dystocies car elles peuvent parfois changer au dernier moment (rotation de 180°). Eventuellement une échographie utérine aide à apprécier la vitalité des chiots par la visualisation de leurs battements cardiaques. LES SIGNES PRECURSEURS DE LA MISE-BAS La semaine qui précède la mise-bas s'accompagne généralement d'une diminution de l'appétit, d'une constipation et d'un développement mammaire. Ces signes sont cependant inconstants surtout chez les primipares qui n'effectuent parfois leur montée de lait que le jour de l'accouchement. Puis la vulve gonfle et se relâche sous l'effet de l'imprégnation oestrogénique, ce qui provoque parfois chez la chienne des manifestations de fausses chaleurs dans les 3 jours précédant et suivant la mise-bas. La température rectale chute de Cette hypothermie transitoire est concomitante de la chute
de Enfin, l'écoulement du bouchon muqueux qui provient du col de l'utérus prévient de l'imminence de la mise-bas et précède de quelques heures (24 à 36 au maximum) les premières contractions. DEROULEMENT NORMAL DELA MISE-BAS La présence de selles compactes dans le rectum (fécalômes) au moment de la mise-bas diminue le passage disponible pour les foetus à travers la filière pelvienne. On veillera donc à la vacuité du rectum lors de la préparation à l'accouchement. On pourra également vérifier l'absence de brides vaginales risquant de faire obstacle à la mise-bas chez les primipares. A moins que la visite pré-natale n'ait décelé des risques
particuliers, il n'est généralement pas nécessaire d'intervenir pendant La durée de la gestation chez la chienne peut varier de 58 à 68 jours, les variations observées étant liées à la différence entre la date de saillie et la date réelle de fécondation. Les premières contractions concernent l'utérus et ne sont souvent décelables extérieurement qu'à la nervosité de la chienne qui observe souvent ses flancs et cherche généralement un coin tranquille pour s'isoler et préparer une litière confortable quand elle ne dispose pas déjà d'un nid de mise-bas. Il arrive toutefois que la chienne recherche alors la sécurité d'une compagnie. L'anorexie (perte d'appétit) est banale pendant cette phase et va d'ailleurs parfois jusqu'au vomissement. Cette phase préparatoire dure en moyenne 6 à 12 heures mais peut durer jusqu'à 36 heures chez une primipare. Si l'éleveur est inquiet, il peut à ce stade apprécier la dilatation vaginale à l'aide d'un ou deux doigts gantés et profiter de cette manipulation pour déceler l'éventuelle présence et la position d'un chiot engagé. L'engagement du premier chiot dans la filière pelvienne
provoque des contractions visibles de la musculature abdominale (réflexe de
Ferguson) qui viennent compléter les efforts expulsifs de l'utérus et doivent
aboutir dans un délai inférieur à 3 heures à la rupture de la première poche
des eaux. La poche amniotique renfermant le chiot peut alors apparaître à la
vulve (maximum 12 heures après la perte des eaux). Si la membrane amniotique
n'a pas été déchirée au passage, la mère s'en charge généralement dans la
minute qui suit l'expulsion, sectionne le cordon ombilical et lèche le thorax
du nouveau-né, ce qui stimule ses premiers mouvements respiratoires. L'éleveur n'intervient
à ce stade que lors de présentations postérieures (environ 40% des
présentations qui sont plus longues à expulser) en aidant la mère par de
légères tractions synchrones aux contractions abdominales ou si le chiot reste
inerte malgré les stimulations maternelles. Il vérifie alors l'absence
d'obstruction des voies aériennes supérieures (fréquente lors de présentations
postérieures), les dégage éventuellement à l'aide d'une poire à lavement ou par
des mouvements centrifuges qui favorisent également l'afflux de sang au
cerveau. Si ces manoeuvres s'avèrent inefficaces, le recours à l'eau froide ou
aux stimulants respiratoires devient nécessaire. Chaque chiot est généralement
suivi dans les 15 minutes de ses annexes (sauf lors de contractions intenses)
qui sont le plus souvent ingérées par SOINS POST-NATAUX Une précaution importante consiste à diriger chaque
nouveau-né vers une mamelle lorsque la mère ne l'y pousse pas spontanément afin
qu'il puisse téter le colostrum (premier lait) qui contient des anticorps
protecteurs procurant au chiot une immunité dite passive par opposition à
l'immunisation active obtenue après vaccination. Lorsque le nombre de
nouveau-nés est inférieur aux prévisions radiologiques, une nouvelle
radiographie abdominale permet de localiser le ou les chiots manquants et évite
une césarienne inutile si on les retrouve...dans l'estomac de |

Copyright(c) 2010 Club du Bleu de Gascogne Gascon Saintongeois Ariégeois. Tous droits réservés.


 CONDUITE DE LA REPRODUCTION EN ELEVAGE
CANIN
CONDUITE DE LA REPRODUCTION EN ELEVAGE
CANIN