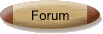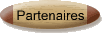LA CONSANGUINITE CANINE
|
La consanguinité canine Les Bases De La Génétique La
consanguinité est par définition l’accouplement de deux individus apparentés,
c'est-à-dire ayant au moins un ancêtre commun. Parler de la consanguinité au
sens large n’a pas de sens car tous les individus appartenant à une même race
sont déjà consanguins. Il faut donc parler en taux de consanguinité ou en
coefficient de parenté pour que le discours ait un sens. Dans cet article sera
développée la consanguinité étroite, c'est-à-dire à fort coefficient de
parenté. La maîtrise
de la consanguinité est indispensable à l’éleveur sélectionneur. Il suffit de
lire les pedigrees de champions dans de nombreuses races pour s’en persuader.
La majorité des éleveurs de renom l’utilise à bon escient, particulièrement les
anglo-saxons. C’est un
sujet passionnant et tabou qui déchaîne les passions mais qui est rarement
traité de manière objective car il demande un minimum de connaissance en
génétique avant d’en aborder la pratique. Haut de page I/ Chromosomes
et Gènes : Les chromosomes
sont de longues molécules d’ADN situées dans le noyau de toutes les cellules de
l’organisme, ils constituent une sorte de « carte à puce » de
l’individu contrôlant à la fois sa morphologie, son métabolisme, son
comportement et même sa pathologie. b)
Transmission aux descendants : La
transmission du matériel génétique à la descendance assure la pérennité de
l’espèce et de ses particularités qui en font une race. Elle se fait grâce aux
cellules sexuelles : spermatozoïde pour le mâle, ovule pour la femelle.
Haut de page II/ Les
Gènes Mendéliens : a)
Définitions : Il s’agit
d’un gène qui contrôle à lui seul un caractère. b)
Exemples : Gène de la
dilution maltaise.
Le génotype D
– d est d’aspect noir mais porte en lui l’allèle d est donc
susceptible de le transmettre à la descendance
Un
accouplement de deux chiens noirs peut donc donner naissance à des chiots bleus
dans la proportion de 25%. c) Génotype et
phénotype : Comme dit
précédemment, le phénotype est l’aspect extérieur du chien, c’est donc
l’enveloppe à l’opposé du génotype qui est le contenu de l’enveloppe. C’est
donc le génotype qui représente un réel intérêt pour l’éleveur alors qu’en
cynophilie, toute la sélection repose sur le phénotype. Tout le
monde connaît des exemples de grands champions incapables de transmettre leurs
qualités et vice et versa, des étalons ou des lices produisant des chiots de
qualité. C’est le point faible de la cynophilie et c’est là où le bon éleveur
doit faire preuve de clairvoyance et d’audace en n’utilisant pas
systématiquement l’étalon en vogue mais celui qui reproduit le mieux. Haut de page III/ Les Facteurs
Polygéniques : A l’opposé
des gènes mendéliens qui contrôlent à eux seuls un caractère, on distingue les
facteurs polygéniques. Haut de page IV/ Génétique
et Milieu : a)
Exemples : Si les gènes
ont une grande importance, ils ne sont pas toujours suffisants pour déterminer
une pathologie. Il faut pour cela que le milieu soit propice. b)
Héritabilité : L’héritabilité
d’un critère est sa faculté à se transmettre à la descendance. * Gènes
pathologiques : On recense
actuellement chez le chien 250 maladies génétiques dont environ une centaine
contrôlées par un seul gène. * Exemples
de gènes mendéliens pathologiques. PRA :
Atrophie Rétinienne Progressive - PRA
Généralisée : Récessif Haut de page Pratique de la consanguinité I/ Définition
du ou des Caractères à Sélectionner : La sélection
en élevage doit être rigoureuse et réfléchie. Il faut avant tout choisir le
caractère à sélectionner, éventuellement deux, trois maximum. On ne peut en
effet sélectionner et fixer simultanément plus de 3 caractères. Par exemple,
une lignée consacrée au mouvement et à la tête, l’autre au poil et à la chasse.
Une fois les caractères fixés dans chacune des lignées on les croise pour
produire des sujets possédant l’ensemble des qualités sélectionnées. Cela
paraît simple sur le papier. La réalité est quelque peu différente car la
consanguinité ne fixe pas que les qualités ; elle fixe aussi les défauts
et les problèmes pathologiques. Il est donc possible par exemple de se retrouver
avec une lignée au mouvement et aux têtes irréprochables mais où les ports de
queue soient catastrophiques. Haut de page II/ Evaluation
des reproducteurs : Elle est indispensable
à l’élevage de sélection. Pas de consanguinité sans une évaluation sévère et
objective des reproducteurs et des chiots produits. Elle demande, de la part de
l’éleveur, expérience, talent et coup d’œil. Les
résultats seront consignés dans un cahier qui sera la mémoire de l’élevage.
L’éleveur peut mettre au point un système de cotation basé sur les résultats
d’expositions ou de travail ou, effectuer sa propre grille de cotation en
attribuant une note à chaque région du corps, au mouvement et au caractère. En
dessous d’une certaine note, l’éleveur renoncera à utiliser ce géniteur. C’est
une sorte de confirmation mais d’un niveau nettement supérieur. Haut de page III/ Création
d’une lignée consanguine : a) In-Breeding et Line-Breeding : Deux termes
anglais pour désigner deux types d’accouplements consanguins à l’opposé de
l’out-crossing (accouplement non consanguine). *
In-breeding : C’est l’accouplement de deux reproducteurs de parenté très
proche. (ex : père/fille – frère/sœur) D’après D. Salon – Séminaire SFC – 1988 D’après
l’exemple, du pedigree ci-joint Vickie est le produit d’un out-crossing, Tina
et Victor d’un in-breeding et l’accouplement Victor/Vickie est un exemple de
line-breeding. La
consanguinité se mesure par le taux de consanguinité qui est d’une grande
complexité et donc impossible à utiliser. En pratique on utilise soit le
coefficient de parenté soit le degré de parenté. * Coefficient
de parenté : probabilité qu’un gène de l’ancêtre commun ait été
transmis à la fois aux deux apparentés.(Ex : 50% entre frère et sœur – 25%
entre grand-père et petite-fille) b) Choix des
reproducteurs : Il est primordial.
C’est la base de la sélection. De plus,
lors de l’utilisation d’un reproducteur extérieur (saillie ou achat) choisi
pour une qualité complémentaire manquante à l’élevage, les chances de succès
seront d’autant plus grandes que son pedigree sera consanguin. Utiliser un
reproducteur issu d’un out-crossing et donc hétérozygote pour de nombreux gènes
est très hasardeux. Il est possible de gagner mais il y a plus de chances de
perdre. c)
Accouplements : Pour
démarrer une lignée consanguine, il faut un crack (mâle ou femelle), pas
seulement un bon chien, mais un chien exceptionnel ! - D’abord la
prolificité, La
prolificité et la robustesse assure la pérennité de la race et priment donc
bien évidemment sur la morphologie. Après deux
ou trois générations, dès que les qualités sélectionnées sont fixées, on
effectue un mariage avec une autre lignée aux qualités complémentaires, si
possible elle-même consanguine, puis on repart en consanguinité étroite. L’idéale est
de posséder soit même plusieurs lignées ce qui permet de gagner du temps. De
plus, l’accouplement de chiens issus de lignées différentes produit des
hétérozygotes qui ne présentent que peu d’intérêt pour la reproduction mais
constitue souvent d’excellents chiots pour la vente et l’utilisation sportive
(effet hétérozys). * Quand
faut-il arrêter la consanguinité ? - Si la prolificité diminue, Avant de
démarrer en in-breeding comme indiqué ci-dessus, il est préférable de faire un
essai en line-breeding. Cela permet de vérifier si la race ou la lignée de
départ supportera l’épreuve de consanguinité étroite et d’éviter dans certains
cas les catastrophes. IV/ Avantages
et Inconvénients de la Consanguinité : Avantages : - Fixer les
caractères et permettre ainsi une certaine progression grâce à la sélection
effectuée simultanément, Inconvénients
et Limites : - Ne rien
créer d’autre que ce qui est présent au départ d’où la nécessité de démarrer
avec un crack faute de quoi on plafonne rapidement, Haut de page Conclusion : Bien
maitriser la consanguinité est un outil extraordinaire pour l’éleveur
sélectionneur. Mais il ne faut pas oublier qu’elle est réservée aux cracks et
aux éleveurs chevronnés et qu’elle possède ses propres limites. L’éleveur
est le détenteur momentané de la race qu’il élève et a le devoir de la
maintenir dans son type sans succomber à la tentation de produire des
hypertypes qui ne seraient que des chiens d’opérette incapables de remplir leur
mission originel. Il a également la lourde tâche de veiller à ne produire que
des chiens sains et de se préoccuper de leur longévité. L’éleveur est avant
tout le premier défenseur de la race qu’il élève. D'après
Fréderic Maison (Docteur Vétérinaire) |